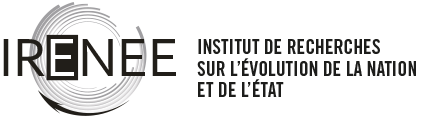Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Olivier PROVINI, Professeur de science politique à l'IRENEE depuis la rentrée universitaire 2025.
 Pouvez-vous nous retracer les étapes de votre parcours qui vous ont permis de devenir Professeur en science politique ?
Pouvez-vous nous retracer les étapes de votre parcours qui vous ont permis de devenir Professeur en science politique ?
Après avoir réalisé des études en science politique (Université Paris 8 puis Université Paris 1), où j’ai eu la chance d’avoir des enseignant·es passionné·es et passionnant·es, j’ai entamé une thèse sur les réformes universitaires en Afrique de l’Est à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Je me suis intéressé à la mise en marché de certaines universités publiques dans la région (Kenya, Ouganda, Tanzanie et Burundi) en essayant de comprendre pourquoi certains systèmes et établissements avaient fait le choix, à la fin des années 1980, de mimer le fonctionnement du marché, quand d’autres y résistaient.
Cette thèse (soutenue en 2015) m’engageant à réfléchir à la conduite de l’action publique dans des États et des régimes politiques peu étudiés en science politique (les États dits fragiles, faillis, néo-patrimoniaux, et les régimes autoritaires et hybrides), m’a permis de travailler avec plusieurs collègues du laboratoire Les Afriques dans le Monde de Sciences Po Bordeaux. Nous avons, notamment avec Dominique DARBON monté un programme de recherche de quatre ans intitulé FAPPA, cofinancé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence française de développement, qui comparait le processus des politiques publiques dans six pays (Maroc, Côte d’Ivoire, Madagascar, Kenya, Tanzanie et Mozambique) et dans quatre secteurs (éducation, foncier, politiques sociales et politiques de la ville).
Fort des résultats et de la visibilité du programme, j’ai été recruté à l’Université de La Réunion comme Maître de conférences en science politique en 2017, en partie pour enseigner les politiques publiques et former les futur·es cadres de la fonction publique du territoire. J’ai profité de ce poste pour engager, avec mon collègue Damien DESCHAMPS, le programme de recherche PPR sur les politiques de l’emploi à La Réunion. Comme c’est souvent le cas avec notre métier, ce programme a engagé toute une réflexion assez inattendue sur la dimension parfois clientélaire de l’action publique. Nous avons démontré comment, parfois, des ressources de l’action publique se convertissent, en toute légalité, en ressources clientélaires pour les élu·es locaux·ales.
À la suite de ce programme de recherche et de la soutenance de mon Habilitation à diriger des recherches en science politique (Sciences Po Bordeaux, 2024), j’ai poursuivi ces recherches sur le clientélisme, le métier d’élu·e et l’action publique, mais en travaillant cette fois-ci sur la Seine-Saint-Denis, grâce à l’obtention de deux années de délégation au CNRS au sein du Centre européen de sociologie et de science politique (Université Paris 1 et EHESS). Je continue depuis à travailler sur cet objet passionnant qui m’engage à réfléchir à la transformation de l’ancienne « banlieue rouge » communiste et sur une modalité du clientélisme peu étudiée : le clientélisme associatif (et ce, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires et de libertés associatives toujours plus menacées).
Enfin, en mai 2025, j’ai été Vice-major du concours de l’Agrégation de science politique, ce qui m’a permis de muter définitivement en métropole et de rejoindre ce beau campus de l’Université de Lorraine.
Mon parcours est donc très ordinaire pour ma discipline. En ayant été allocataire de recherche pour ma thèse, vacataire, attaché temporaire d’enseignement et de recherche puis en ayant réussi à être titularisé, il rappelle (malheureusement) la grande précarité et incertitude des enseignant·es-chercheur·ses en France. Mais, pour finir sur une note plus positive, en ayant pu changer assez régulièrement d’objets et de terrains de recherche, ce parcours est aussi le reflet de la très grande liberté académique que rend possible notre métier. À nous de ne pas l’oublier et de continuer à se battre pour ce privilège indispensable aux fonctionnements de la recherche et de la science.
- Quelles sont vos ambitions au sein de l'IRENEE et de l'IAE de Nancy ?
J’arrive à l’IRENEE avec mon bagage de spécialiste en analyse des politiques publiques, du métier d’élu·e, en politique comparée et, plus généralement, avec mes connaissances sur l’état des savoirs et des controverses en science politique. Je partage de nombreux points de recherche communs avec mes collègues politistes, notamment Prunelle Aymé, recrutée comme titulaire l’année dernière, et avec qui nous devrions collaborer dans le cadre d’un séminaire de recherche que je coordonne cette année à Paris sur « l'Action publique en Seine-Saint-Denis » (CESSP, CNRS Pouchet).
Durant mes huit années passées à La Réunion, j’ai beaucoup échangé et travaillé avec les juristes, notamment les privatistes et les historiennes du droit du campus. Je suis absolument convaincu qu’il y a un enjeu — après la rupture du « moment 1900 » où les juristes ont fait le choix de la doctrine, de la technique juridique et de la professionnalisation en tournant le dos aux sciences sociales — de lier beaucoup plus systématiquement la science politique et le droit. Nous ne devons pas oublier que nous travaillons tous·tes, même indirectement, sur l’État et ses transformations. Je souhaite poursuivre ces réflexions dans le cadre de l’IRENEE, notamment avec mes nouveaux·elles collègues juristes. J’espère, par exemple, capitaliser sur le travail qui vient de paraître sur l’incidence des instruments de financement sur les pratiques de recherche des juristes (revue Gouvernement et action publique, 2024). Mais je souhaite surtout me laisser surprendre par les affinités de recherche, les rencontres et les projets que mes collègues portent déjà pour tenter, modestement, d’y contribuer également.
Enfin, à l’IAE Nancy, j’ai été recruté pour y enseigner, avec ma collègue politiste Claude PROESCHEL, les cours de science politique avec, pour ma part, un volet sur les politiques publiques, la sociologie des élites ainsi que des enseignements de culture générale en vue de la préparation aux concours administratifs. J’espère sincèrement pouvoir apporter aux étudiant·es que je vais accompagner de la curiosité et de la stimulation intellectuelle et leur montrer que les établissements universitaires sont, avant tout, des lieux où se produit et se diffuse le savoir scientifique — ce qui est souvent compatible avec les enjeux d’une professionnalisation en dehors du monde académique.
- Quels sont pour vous les atouts spécifiques d’une carrière en science politique (qui pourraient motiver les doctorants vers cette voie) ?
Ils sont nombreux — même si c’est une carrière exigeante où, malheureusement (et il faut continuer à lutter !), les ressources et débouchés sont limitées dans le champ.
Je pense tout d’abord qu’une carrière en science politique, comme d’autres cursus, permet de bien comprendre les enjeux en histoire des sciences, en philosophie des sciences et en épistémologie. Cette dimension, souvent oubliée, me semble absolument primordiale dans des sociétés toujours plus complexes et où le savoir, la recherche et la science sont discutés (c’est bien normal !), discrédités et fragilisés (ça me semble plus dangereux).
Ensuite, embrasser une carrière d’enseignant·e-chercheur·se, c’est accomplir des missions extrêmement diversifiées et se familiariser avec tout un ensemble de compétences : la lecture et l’écriture scientifiques, la réalisation d’un terrain de recherche, le déploiement de méthodes croisées pour tester des hypothèses, ou encore, la familiarisation avec le travail en équipe à travers la réalisation de programmes de recherche collectifs et ambitieux. Le doctorat est également souvent une étape où on commence à enseigner, à évaluer un peu mieux si ce métier « peut nous plaire », où on commence à suivre des étudiant·es, à les encadrer et les accompagner ; et c’est enfin une immersion dans la « boite noire de l’université » : les échanges précieux avec le personnel administratif, mais aussi une meilleure compréhension des défis et des enjeux actuels de l’enseignement supérieur français (le manque de ressources, les rares titularisations, le recours à la contractualisation et à la précarisation, ou encore, la dimension toujours plus néolibérale de nos métiers et institutions). L’université n’est pas une institution hors-sol mais, elle aussi, est travaillée par ces défis.
Les doctorats en science politique forment d’excellent·es chercheur·ses et enseignant·es aujourd’hui, pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre dans le champ universitaire ; mais ces doctorats forment également, grâce aux nombreuses compétences acquises (rigueur, rédaction, montage de projet, prise de parole en public, organisation, etc.), d’excellent·es professionnel·les en dehors du champ académique, comme dans l’administration publique, les sociétés de conseil et de consultance, les organisations internationales, les associations ou encore les collectivités.
Que les étudiant·es, notamment masterant·es, n’hésitent jamais à venir nous voir et à nous contacter pour en discuter !