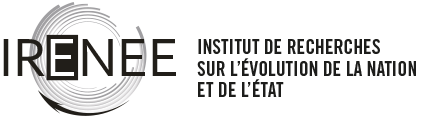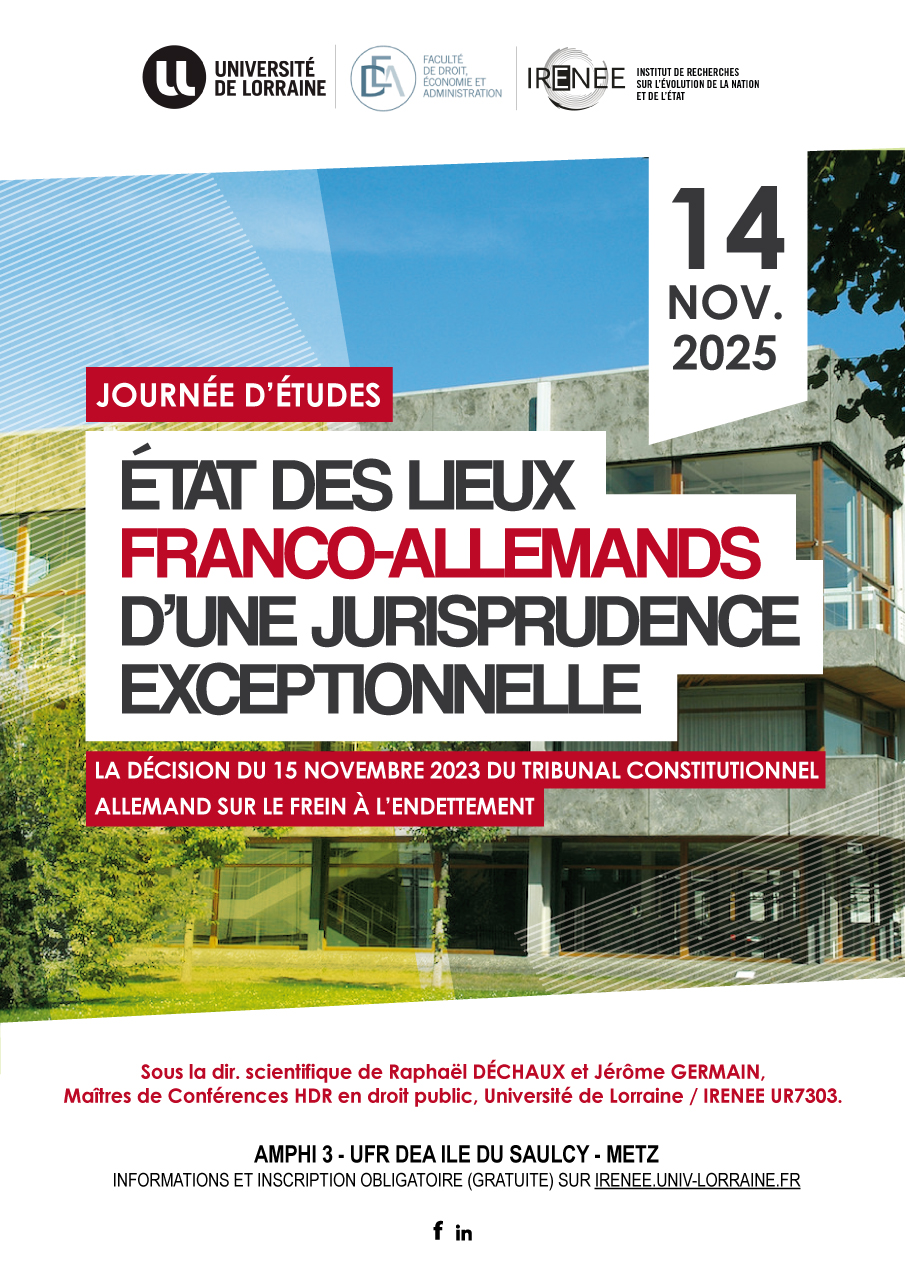 État des lieux franco-allemands d’une jurisprudence exceptionnelle : la décision du 15 novembre 2023 du Tribunal constitutionnel allemand sur le frein à l’endettement
État des lieux franco-allemands d’une jurisprudence exceptionnelle : la décision du 15 novembre 2023 du Tribunal constitutionnel allemand sur le frein à l’endettement
Vendredi 14 novembre 2025
AMPHI 3 - Faculté DEA - ILE DU SAULCY METZ
Sous la direction scientifique de Raphaël DÉCHAUX et Jérôme GERMAIN, Maîtres de Conférences HDR en droit public, Université de Lorraine / IRENEE UR7303.
- Inscription en présentiel obligatoire (gratuite) en cliquant-ici
- Programme détaillé
Au programme 3 tables rondes : - 1re table-ronde : Quelle légitimité du contrôle juridictionnel des règles budgétaires ?
La première table-ronde permettra d’abord d’échanger sur les conséquences de la décision du 15 novembre 2023 sur la légitimité du juge constitutionnel allemand. Comment cette jurisprudence a-t-elle été accueillie par les juristes, les économistes et les politistes ? Quels consensus ont pu apparaître au sein des doctrines universitaires en faveur et en défaveur de l’argumentation du juge ? De quel degré d’activisme ou de self-restraint la Cour de Karlsruhe a-t-elle fait preuve ? Cette décision était-elle inévitable à l’aune de la révision constitutionnelle de 2009 ? La discussion sera ensuite l’occasion de comparer la jurisprudence et la légitimité du juge allemand avec celles du juge français : une telle décision serait-elle possible en France ? Comment le Conseil constitutionnel interprète-t-il désormais le principe d’équilibre ? La révision de mars 2025 illustre-t-elle ce dogme selon lequel « le juge constitutionnel n’a toujours pas le dernier mot », ainsi que le prônait le Doyen Favoreu dans sa théorie de l’aiguilleur ?
- 2e table-ronde : Les pouvoirs financiers des Parlements diminués face à l'endettement public ?
La deuxième table ronde permettra d’interroger l’étendue des pouvoirs financiers du Parlement à la suite de la décision du 15 novembre 2023. Alors que les principes budgétaires constitutionnels en France sont – classiquement – présentés comme n’imposant qu’une contrainte formelle et procédurale au législateur, le frein à l’endettement vient, quant à lui, limiter son opportunité. La jurisprudence constitutionnelle allemande conduit-elle donc à un encadrement acceptable du pouvoir financier parlementaire ? Comment les premiers concernés, les parlementaires, ont-ils accueilli cette décision ? A-t-elle permis un débat sur l’étendue de ces pouvoirs ? Le Parlement demeure-t-il au centre de la décision financière ? La théorie démocratique classique – incarnée par l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – fait du pouvoir financier un élément central du régime parlementaire : n’est-ce pas ce dernier qui se trouve altéré par les juges constitutionnels ? Comment ce débat allemand résonne-t-il en France, où la limitation du pouvoir financier résulte avant tout de l’action du pouvoir exécutif ? D’un point de vue plus général, la restriction du pouvoir budgétaire ne favorise-t-elle pas le populisme et « l’illibéralisme », au détriment du « gouvernement des juges » ?
- 3e table-ronde : Le financement des investissements d'avenir sera-il constitutionnel ?
La troisième table ronde sera l’occasion de concentrer les échanges sur les conséquences de la décision du 15 novembre 2023. Le financement des investissements d’avenir – tels que ceux portant sur la transition écologique – est-il fondamentalement remis en question par le juge constitutionnel ? Plus généralement, le politique peut-il toujours proposer des investissements impliquant un endettement massif ? La jurisprudence a-t-elle conduit à une remise en question du dogme allemand en matière d’endettement ? Comment prévoir les effets de la révision de mars 2025 sur la politique économique du gouvernement ? Peut-on imaginer d’autres secteurs concernés, comme pourrait le laisser entendre la commission de réflexion nommée récemment par le ministre de l’Économie ? Ou faudra-t-il revoir complètement le mécanisme du frein à l’endettement ? La question se pose différemment en France, compte tenu de la situation de la dette publique nationale. Toutefois, la nécessité de ces investissements d’avenir se fait tout autant sentir qu’en Allemagne. Peut-on imaginer que, malgré l’effort indispensable de réduction des déficits publics, la France fasse preuve d’une même forme d’exceptionnalisme afin de financer la transition écologique ? Faudra-t-il également réviser la Constitution de 1958 ou la LOLF, ainsi que l’a proposé le Conseil d’État dans son étude annuelle de 2025 ?
- Présentation : La décision du 15 novembre 2023 du Tribunal constitutionnel allemand constitue une décision sans précédent. La budgétisation de 60 milliards d’euros a été annulée par le juge constitutionnel pour violation de la « règle d’or » à l’allemande – « frein à l’endettement » (Schuldenbremse) – prévue par l’article 109 alinéa 3 de la Loi fondamentale tel qu’issu de la 57e révision constitutionnelle du 29 juillet 2009.
Un peu plus de dix ans après l’adoption du TSCG, le juge constitutionnel allemand a ainsi rappelé avec fermeté au Parlement l’étendue de son pouvoir financier, dans ce qui peut être considéré comme l’une des décisions les plus marquantes en matière financière de notre époque. Tant l’ampleur des crédits annulés que l’audace du juge ont suscité un débat important en Allemagne, d’autant plus que cette annulation a entraîné la suppression d’un fonds spécial pour le climat, destiné à soutenir la transformation de l’économie et à financer la transition énergétique. Les enjeux sont de trois ordres :
• constitutionnel, tout d’abord. La décision interroge la légitimité du juge de Karlsruhe et sa place au sein des institutions fédérales. S’agit-il d’une interprétation stricte de la Loi fondamentale ou d’un activisme judiciaire frôlant le spectre du « gouvernement des juges » ?
• financier, ensuite. Le pouvoir financier du Parlement allemand apparaît limité dans une proportion sans commune mesure avec celui de ses voisins européens. Cette jurisprudence est-elle dès lors soutenable d’un point de vue théorique et pratique ?
• politique, enfin. L’importance d’investir massivement dans la transition énergétique n’est plus à démontrer, tant pour l’Allemagne que pour l’ensemble des États européens. Quelles alternatives économiques et quelles politiques publiques peuvent être envisagées pour compenser cette perte sèche de 60 milliards d’euros ?
Dresser le bilan de cette jurisprudence est nécessaire, quelques mois après la révision constitutionnelle de mars 2025, qui prend le contrepied de celle de 2009. Alors que les limites de l’approche européenne de l’endettement et du "modèle allemand" apparaissent de plus en plus clairement (rapport Draghi, guerre en Ukraine...), la pertinence de cette décision est-elle remise en cause outre-Rhin ? Quelles leçons peut-on en tirer pour la France ? Enfin, comment cette jurisprudence a-t-elle été accueillie au sein de l’Union européenne, tant par les institutions que par les États membres ?