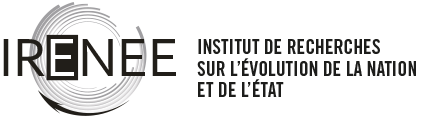La revue Civitas Europa n°53 - La réforme des retraites de 2023 est disponible en version papier et sur CAIRN en cliquant-ici
> N'hésitez à vous abonner à la revue ou à commander ce numéro spécial, en cliquant-ici
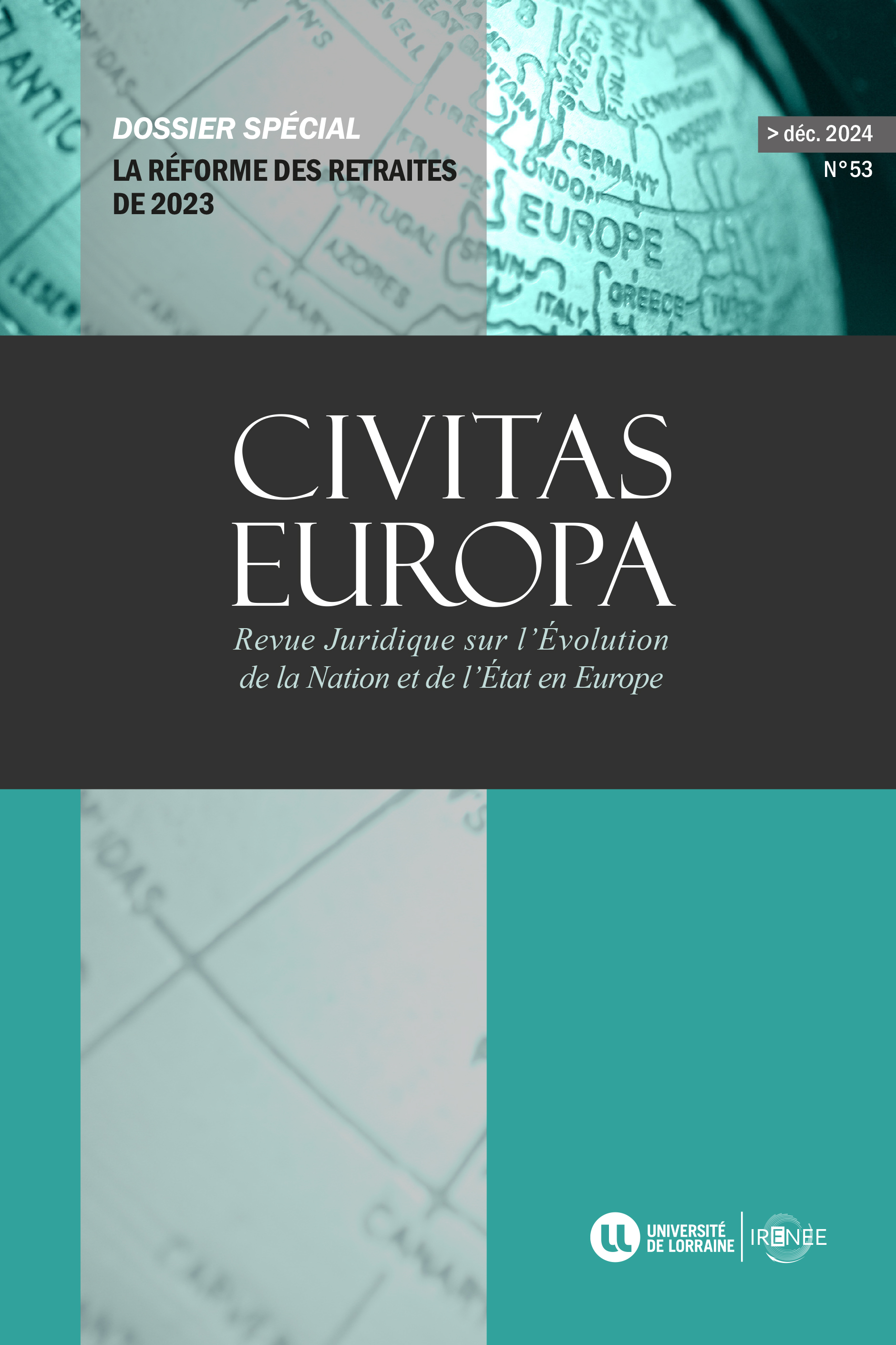
[EXTRAIT] Introduction - Réformer les retraites : une histoire française
par Dominique ANDOLFATTO, Professeur de science politique, Université de Bourgogne / CREDESPO
La réforme des retraites s’inscrit dans les multiples changements, tournants, mutations (même si ces termes, répétés à l’envie, semblent parfois dépréciés) qui caractérisent la France contemporaine. L’une des traductions politiques de ces changements serait ce « vote disruptif », selon l’expression de Pascal Perrineau, qui, en 2017, a vu l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République et ouvrait un « processus de destruction créatrice d’une rare intensité » du système politique. Bruno Cautrès et Anne Muxel ont évoqué aussi une « crise systémique d’ensemble du système politique », une « révolution électorale ». Le sociologue Michel Wieviorka a parlé parallèlement de « métamorphose » concernant la méthode de l’action publique, les résistances à celle-ci, les structures collectives. Cela étant, le débat n’est pas tranché sur les processus en cours, leurs origines ou diagnostics, sans parler de nouvelles accélérations ou rebondissements après les élections européennes et législatives de 2024.
Après l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, un autre élément de rupture doit être souligné : le mouvement des « gilets jaunes », en 2018-2019, mouvement social totalement inédit selon certains, anti-mouvement social selon d’autres. Celui-ci interroge les évolutions de l’action collective et le rôle des organisations traditionnelles, notamment syndicales, censées l’encadrer ou la promouvoir, lesquelles ont semblé dépassées ou ont préféré regarder ailleurs, en dépit de tentatives de convergences. En fait, c’est un autre monde du travail – celui des petites et moyennes entreprises et de territoires périphériques, bien souvent à l’écart du syndicalisme traditionnel – qui s’est mis en scène et a intégré parfois des syndicalistes locaux, mais sans que leurs organisations rencontrent ces militants des ronds-points.
Autre rupture évidemment : la crise sanitaire. Plusieurs contributeurs de ce dossier sur les retraites ont déjà eu l’occasion de s’interroger dans un livre collectif – Citoyens dans la crise sanitaire – sur l’impact de cette crise pour la démocratie politique, sociale ou sanitaire et ont observé et analysé des régressions, tant dans la fabrique de l’action publique que dans des formes de participation que le pouvoir politique a alors instrumentalisées.
Enfin, la crise récurrente des retraites pose de nouveau les questions de la fabrique des politiques publiques, de l’action collective et, plus largement, du « bon gouvernement » compte tenu de dysfonctionnements démocratiques qui se sont produits à nouveau.
Cette crise – objet de ce dossier – a connu un premier acte, au tournant de 2019-2020, avec un projet de nouveau système de retraite universel, sinon « révolutionnaire » à plusieurs titres, car faisant table rase de l’héritage d’un certain « modèle social » français, certes en difficultés, mais ce projet fut finalement abandonné car vu comme trop incertain, sinon insincère dans ses objectifs, sans parler du blocage de la réforme du fait de l’épidémie de covid-19 .
Cette première réforme des retraites lancée par le gouvernement Philippe a donc été interrompue et n’a pas été reprise. Mais Emmanuel Macron annonce la relance d’une réforme lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2022. Il reste néanmoins assez laconique, tout en privilégiant implicitement une réforme paramétrique, c’est-dire jouant sur des paramètres classiques (et notamment l’âge de départ à la retraite), sans remettre en cause l’architecture du système lui-même. Au contraire du système « à points », cette réforme s’inscrirait dans la même perspective d’ajustement comptable que celles mises en œuvre, depuis 1993, à la suite du Livre blanc sur les retraites, commandé par Michel Rocard. Ce dernier, alors Premier ministre, avait fait réaliser une expertise afin d’actualiser – selon ses termes –, par la concertation, le « contrat entre les générations », en combinant « avenir des jeunes générations » et « reconnaissance » pour les anciens, tout en rejetant toute « réforme radicale ».